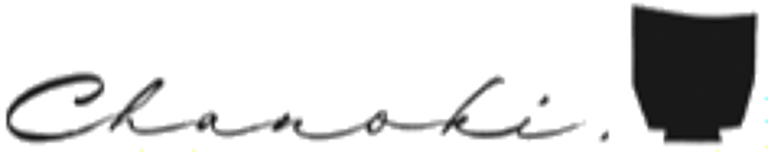Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Muromachi
Partons à la découverte du thé japonais à l'époque Muromachi.


Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Muromachi
Le thé s’est diffusé lentement, d’abord boisson réservée au monde bouddhique, sa consommation s’étend au monde laïc, en restant l’apanage d’une petite élite. L’époque Muromachi, ère de bouillonnement intellectuel et artistique, voit la naissance de nombreux arts emblématiques du Japon. Le thé profite de cette effervescence, et on observe une hausse du nombre de ses consommateurs. Le zen délivre un enseignement et des préceptes au cœur desquels éclot ce qui deviendra la cérémonie du thé.
L’époque Kamakura avait vu la production de thé s’étendre en direction du Kantō. L’expansion de la production à l’époque Muromachi s’est-elle faite en direction de nouvelles régions ou à l’intérieur des régions déjà productrices ? Le transfert du pouvoir à Kyōto a-t-il entraîné la disparition des jardins de thé de la région du Kantō ? Un travail de compilation nous permet une première constatation. Les jardins de thé sont mentionnés dans 23 provinces sur les 68 que comptait le pays. Ces jardins s’étendent du sud de Kyūshū à une nouvelle limite nord (Shimousa). La production est donc présente à l’époque Muromachi sur presque tout l’archipel japonais.
On note un léger accroissement du nombre de mentions de jardins de thé. Les régions du Kinki sont toujours prédominantes, quelle que soit l’époque, avec un taux d’évocation supérieure à 70 %. Comme pressenti, on observe une chute de la représentation dans les sources de la région du Kantō, aussi bien en nombre qu’en proportion. Le transfert du pouvoir à Kyōto semble avoir entraîné une chute de la production dans le Kantō. Un basculement de la production de thé parait s’effectuer vers le Kinai et l’île de Kyūshū. Ces deux régions concentrent alors plus de 80 % des jardins de thé cités dans les textes.
Cet accroissement de la production va s’accompagner du développement d’un tout nouvel écosystème autour du thé.
Les thés les plus mentionnés sont ceux destinés à être bus en poudre. Au XVe s., le thé est désigné soit par le nom de sa région, soit en reprenant le nom d’un thé chinois. Ils désignent en Chine soit des thés en feuilles, soit des thés en briques. Au Japon, ils désignent des thés en feuilles comme en témoignent le Isei teikin ōrai 異制庭訓往来. Il semble que les Japonais aient repris ces noms afin d’établir une hiérarchie et alors que les noms choisis désignent en partie des thés compressés, au Japon le thé était réduit en poudre. À compter du milieu du XVe s., cette coutume disparaît. Les appellations de type « thé moulu », « thé nouveau », « vieux thé », sont en forte augmentation. Le « thé nouveau » et le « vieux thé » désignent des thés selon leur date de fabrication sans hiérarchie de valeur. Quant au « thé moulu », il définit la poudre de thé obtenue après mouture des feuilles. Le thé d’Uji est désigné de trois manières différentes : mujō, betsugi et sosori désignant des nuances de qualité. Ce sont là les premières appellations japonaises pour désigner des thés.
Le Kissa ōrai 喫茶往来 décrit les premières rencontres de thé. Elles se déroulent en trois temps, avec des modalités proches de la cérémonie du thé telle qu’elle sera précisée au XVIe s. Ces réunions étaient l’occasion de boire du thé, d’y pratiquer des concours de thé, parfois accompagnés de paris. En 1336, sont publiés les édits de l’ère Kenmu. Le régime interdit alors ces réunions. Au XIVe s., le thé en poudre était privilégié par les élites, mais ce n’était pas le seul mode de consommation. Le thé en feuilles bu sous forme de décoction ou infusé 煮茶 (nicha) est également pratiqué, comme l’attestent des poèmes. On peut se demander si cette manière alternative de boire du thé signale le début d’une consommation populaire et quel pouvait être l’accès au thé pour le peuple durant cette période ?
Les cultivateurs de thé consomment sûrement leurs thés. Sans doute, s'agit-il de thés en feuilles infusés. Cette consommation ne concerne qu’une infime partie de la population : les volumes, ou encore les méthodes de conservation, ne permettaient pas l’accès du thé à un large public. Pourtant, dès 1403, les premiers vendeurs de thé apparaissent dans le Tōji hyakugō monjo. Ces vendeurs officiaient devant les temples et sanctuaires. Ils préparaient et vendaient sans doute une sorte de bancha.
On retrouve ces figures de vendeurs dans plusieurs pièces de théatre kyōgen. Ces premiers vendeurs de thé se trouvaient près du temple Tōji et du sanctuaire de Gion à Kyōto. Tous les passants pouvaient ainsi consommer du thé. De telles scènes sont observables sur un des paravents dits Rakuchū rakugai zu byōbu.
On peut supposer que les vendeurs étaient liés à ces lieux de cultes. Lieux de passage et d’échange, ils étaient sans doute particulièrement à même de diffuser la consommation de cette nouvelle boisson à Kyōto où se côtoyaient nobles, guerriers, marchands, colporteurs. Cette ville était le meilleur endroit possible pour faire découvrir le thé. Les temples ne sont pourtant bientôt plus indispensables et les vendeurs s’éloignent des lieux de cultes pour vendre au plus près de la ville.
La vente de thé constituera bientôt à Kyōto un commerce à part entière. Petit à petit, des paravents représentent des échoppes représentatives des commerces que l’on trouve le long des routes principales, et que décrivent encore une fois les pièces de kyōgen. La multiplication de ces échoppes indique une hausse probable des consommateurs. On y propose du matcha et des thés en feuilles. Des représentations iconographiques mettent en scène différentes régions, ce qui laisse supposer, en dépit de la rareté des sources écrites, que le thé était consommé plus largement.
Aller plus loin :
Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Heian.
Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Kamakura.
Bibliographie
Graham Patricia J., « Documents and monuments in the history of the sencha ceremony in Japan », Kansai Daigaku Tōzai gakujutsu kenkyūjo kiyō, 1993, vol. 26, p.53.
Hashimoto Motoko 橋本素子, « Kamakura jidai ni okeru sō kissa bunka no juyō to tenkai ni tsuite – Kenmitsu jiin wo chūshin ni – » 鎌倉時代における宋喫茶文化の受容と展開についてー顕密寺院を中心にー (Acceptation et développement de la culture de la consommation du thé de la Chine des Song à l’époque Kamakura en se concentrant sur le temple Kenmitsu), Nara shien, 2001, n°46, p.24.
Itō Umeno 伊藤うめの, « Hacha no inyō no rekishi 3 – Kamakura jidai ikō no incha ni tsuite » 葉茶の飲用の歴史 – 鎌倉時代以降の飲茶について (Histoire de la consommation du thé en feuilles 3, à propos de la consommation de thé après l’époque Kamakura), Fūzoku, vol.13, n°1, 1974, p.33.
Musée national de Kyōto, Nihonjin to cha – sono rekishi・sono biishiki : Tokubetsu tenrankai 日本人と茶—その歴史・その美意識 : 特別展覧会 (Les Japonais et le thé. Histoire et sens du beau : exposition spéciale). Kyōto, Musée national de Kyōto, 2002, p.107.
Nihon kyōkai shi 日本教会史 (Histoire de l’Église du Japon), 1620, Rodrigues João (1561-1633), Ema Tsutomu 江馬務, Ikegami Mineo 池上岑夫 et al. (trad.), vol.2, Tōkyō, Iwanami shoten, 1970.
Verschuer Charlotte von, Le commerce entre le Japon, la Chine et la Corée à l’époque médiévale, VIIe-XVIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Zhang Jianli 張建立, « Muromachi jidai ni okeru chaen to seicha » 室町時代における茶園と製茶 (Champs de théiers et fabrication du thé à l’époque Muromachi), Ritsumeikan bungaku, n°574, 2002.