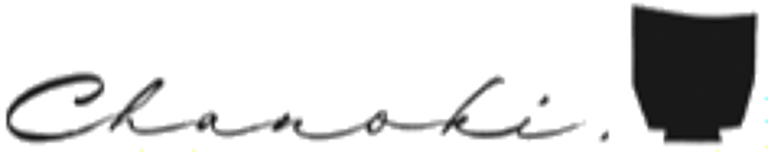Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Heian
Partez à la découverte de l'histoire du thé japonais.


Histoire du thé au Japon. Le thé à l'époque Heian
Les informations que nous donnons seront un résumé de notre doctorat disponible en libre accès sur theses.fr
Les sources (majoritairement en japonais) seront indiqués dans les commentaires.
Nous entamons ce voyage historique par l’introduction du thé au Japon.
Trois moines se disputent le titre de premier introducteur du thé au Japon, Saichō (767-822), Kūkai (774-835) et Eichū (dates inconnues), il ne faut cependant pas trop se fier à leurs écrits. En effet, les premières traces du thé sur l’archipel pourraient se situer un peu plus tôt, pendant l’époque Nara (710-784).
Les Annales et anecdotes du Tōdaiji (東大寺要録, compilé à partir de 1106) rapporte que l’empereur Shōmu (701-756) et le moine Gyoki (668-749) auraient fait pousser des théiers. Le Kujiyakuchō au XVe siècle rapporte aussi qu’une centaine de moines auraient récité le sūtra du cœur au palais impérial et y auraient consommé du thé. Cependant, ces écrits sont bien postérieurs et on ne peut pas complètement s’y fier. D’autant plus que rien n’est noté dans les Suites des Chroniques du Japon 続日本紀 (797).
La découverte de tablette de bois dans les documents du grenier impérial au Tōdaiji (正倉院文書) sur lesquelles apparaît le caractère 荼 est venu lancer le débat sur le sens de ce caractère. Cependant, il semblerait que le caractère désigne plutôt un légume ou une plante de la famille du chardon, et ce, quand bien même le caractère 荼 reviennent régulièrement dans les épitaphes jusqu’à l’époque Tang avant d’être remplacé définitivement par 茶.
Il convient de préciser que la présence ténue du thé dans les textes signalent au moins une chose de manière claire : si la consommation du thé avait commencé à cette époque, elle ne devait être qu’extrêmement marginale.
Des objets datés de l’époque de l’empereur Kanmu 桓武天皇 (781-806) ayant pu servir à la dégustation ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Cependant, la majorité des chercheurs considère que le thé est plutôt arrivé vers le début du IXe siècle. Dans le Hiesha shintō himitsuki 日吉社神道秘密記, est écrit que le moine Saichō aurait créé un champ de thé en 805. Dans une autre partie du recueil, on peut lire :
Il y a un grand nombre de théiers sur les terrains du temple d’Anyōji. C’est le grand moine Denkyō daishi (Saichō) qui les ramena de Chine.
Pourtant, les historiens préfèrent se fier en priorité aux Nihon kōki 日本後紀complétées en 840 où il est fait référence au thé dans un texte concernant l’année 815 : cette année-là, le moine Eichū, de retour de Chine, aurait rapporté des graines de théiers et une méthode de fabrication du thé. Cette méthode pourrait être celle permettant la fabrication de thé compressé (dancha 団茶), en vigueur en Chine à cette époque-là. Plus loin, on apprend que le moine Eichū a proposé du thé à l’empereur Saga 嵯峨天皇 (786-842) :
Le 22e jour (de la 4e lune de l’année 815), l’empereur se rendit à Karasaki dans la région de Shiga dans la province d’Ōmi. […] Le moine Eichū offrit à l’empereur du thé préparé de ses propres mains.
Nous savons grâce à ce texte que le thé poussait dans plusieurs provinces situées non loin de Kyōto.
Des allusions au thé se retrouvent par la suite dans les anthologies poétiques du IXe siècle comme le Ryōunshū 凌雲集 (814), le Bunka shūreishū 文華秀麗集 (818), et le Keikokushū 経国集 (827). Qu’en était-il vraiment de la place du thé et comment cette présence à la cour et dans les temples se manifestait-elle ?
Dès l’époque de l’empereur Saga, le thé était cultivé dans l’enceinte du palais impérial. Ce thé a sans doute servi à la préparation de médicaments et à des cérémonies bouddhiques. Ces jardins ont-ils pu servir à fournir la cour ? Il est peu probable, car le thé ne semble pas encore être consommé régulièrement. La littérature ne mentionne jamais directement le thé. Le caractère du thé 茶 apparaît une fois pour désigner un bol 茶碗 dans le “Dit des Heike” 平家物語, (XIVe s.). Dès lors, que boit la noblesse ? Comme nous le montre le “Chōshūki” 長秋記 (1087-1136) de Minamoto no Morotoki 源師時 (1077-1136), les nobles boivent principalement de l’eau chaude. Le thé est peu mentionné dans les textes, et les objets peu abondants, on suppose donc que la production était réduite. Malgré cette faible production, nous devons nous interroger sur ce qu’était ce thé, et ce que buvait l’empereur Saga ? Le thé aurait été importé de Chine par des moines. C’est ce qui est écrit dans le “Henjō hakki seirei-shū” 遍照発揮性霊集 (834-835), et le “Keikokushū” où l’on apprend que Kūkai aurait apporté du thé à l’empereur. On peut penser qu’il en est de même pour Saichō. Le thé de cette époque était du thé compressé. Or, selon Kumakura Isao le thé compressé n’était pas du goût des Japonais de l’époque, ce qui aurait entraîné sa disparition relative par la suite. Selon Zhang Jianli, l’idée qu’on aurait consommé du thé compressé ne se fonde que sur “Le classique du thé”. Même si, dans un de ses poèmes, il dit qu’on ne peut s’épargner de moudre le thé, anecdote confirmée par l’”Histoire du pays à classement méthodique” qui la date de l’ère Kōnin (814). Le fait de moudre le thé nous renvoie inévitablement au thé compressé.
Le thé a-t-il disparu du Japon après l’empereur Saga ?
L’empereur Saga permit au thé de se développer suffisamment pour subsister çà et là. Son rôle est symbolique, mais en décrétant que le thé devrait être fourni comme tribut, un embryon de production a vu le jour. Les références se font plus rares, mais au moins une trentaine d’occurrences ont été répertoriées entre sa mort (942) et la fin de Heian. Les historiens ont longtemps affirmé que le thé avait disparu jusqu’à son retour à la fin du XIIe siècle, alors que les moines n’ont jamais cessé de servir du thé lors de cérémonies. En dehors de ceux-ci, le thé a continué à être consommé. Un poème de Yoshishige no Yasutane 慶滋保胤 (933-1002), laisse même entendre que des jardins sont présents en dehors du Kinai. 170 ans après la mort de l’empereur Saga, Yasutane chante les jardins de thés de Mikawa. Sugawara no Michizane 菅原道真 (845-903) évoque dans des poèmes sa consommation de thé en remplacement de l’alcool dans ses périodes d’abstinence. Il utilise alors le terme de meiyō 茗葉 « thé en feuilles ». Les historiens ont longtemps avancé que le thé bu à cette époque était de type thé compressé. Or, dans les poèmes de l’époque Tang, le thé des moines est fait à la main, le thé compressé est très peu utilisé. L’utilisation de thé compressé requiert une grande technicité alors qu’un thé en feuilles convient très bien à une consommation personnelle. Ce dernier était probablement de type thé flambé (aburi-cha 炙茶), car un thé des plus simples à fabriquer.
Quelle pouvait être la consommation du thé en dehors des cercles monastiques ? Elle a été minime, sans doute le fait exclusif de hauts dignitaires de la cour. Même parmi elle, la consommation ne semble pas avoir été régulière. Dans les monastères, au contraire, le thé était déjà bien implanté. On doit donc essentiellement aux monastères la continuité de la production et de la consommation jusqu’au commencement du XIIIe siècle.
Bibliographie
Adachi Isamu 足立勇, Sakurai Shū 桜井秀, Sasakawa Rinpū 笹川臨風, Nihon shokumotsu shi 日本食物史 (Histoire de l’alimentation au Japon), Tōkyō, Yūzankaku shuppan, 1973.
Bencao gangmu 本草綱目 (Traité exhaustif de pharmacopée), 1578, Li Shizhen李時珍(1518-1593), Suzuki Shinkai 鈴木真海, Shirai Mitsutarō 白井光太郎, Kimura Kōichi 木村康一 (éd.), 15 vols., Tōkyō, Shunyōdō shoten, 1975.
Despeux Catherine, « Quelques éléments de l’histoire du thé » dans Chajing 茶経 (Le Classique du thé), VIIIe siècle, Lu Yu 陸羽 (733-804), Catherine Despeux (trad.), Paris, Rivages poche, 2015.
Guillaume Hurpeau. Histoire du thé au Japon : techniques culturales et de fabrication du thé à l'époque Edo. Histoire. Université Paris sciences et lettres, 2018. Français.
Iwama Machiko 岩間眞知子, Cha no iyaku shi 茶の医薬史 (Histoire médicinale du thé), Kyōto, Shibunkaku, 2009.
Kumakura Isao 熊倉功夫, Cha no yu no rekishi 茶の湯の歴史 (Histoire de la cérémonie du thé), Tōkyō, Asahi shimbunsha, 1990.
Makino Tomitarō 牧野富太郎, Nihon shokubutsu zukan 日本植物図鑑 (Encyclopédie illustrée de la flore du Japon), 26e éd., Tōkyō, Hokuryūkan, 1974.
Murai Yasuhiko 村井康彦, Cha no yu no rekishi 茶の湯の歴史 (Histoire de la cérémonie du thé), Tōkyō, Tankōsha, 1969.
Murai Yasuhiko 村井康彦, Cha no bunka shi 茶の文化史 (Histoire culturelle du thé), Tōkyō, Iwanami shinsho, 1979.
Musée national de Kyōto, Nihonjin to cha – sono rekishi・sono biishiki : Tokubetsu tenrankai 日本人と茶—その歴史・その美意識 : 特別展覧会 (Les Japonais et le thé. Histoire et sens du beau : exposition spéciale). Kyōto, Musée national de Kyōto, 2002.
Nakamura Shūya 中村修也, « Yōsai izen no cha » 栄西以前の茶 (Le thé avant Yōsai) dans Tanihata Akio 谷端昭夫, Sadōgaku taikei dai 2 kan 茶道学大系2巻 (Bibliothèque complète des études sur la voie du thé, vol.2), Kyōto, Tankosha, 1999.
Nakamura Yōichirō 中村洋一郎, Bancha to nihonjin 番茶と日本人 (Le bancha et les Japonais), Tōkyō, Yoshikawa Kōbunkan, 1998.
Nihon kōki 日本後紀 (Chroniques postérieures du Japon), 840, Kuroita Nobuo 黒板伸夫, Morita Tei 森田悌 (éd.). Tōkyō, Shūeisha, 2003.
Takahashi Tadahiko 高橋忠彦, « Tōshi ni miru tōdai no cha to bukkyō » 唐詩にみる唐代の茶と仏教 (Thé de l’époque Tang et bouddhisme à travers les poèmes de cette époque), Tōyō bunka, n°70, 1990.
Tani Akira 谷晃, Chajintachi no Nihon bunka shi 茶人たちの日本文化史 (Histoire culturelle du Japon des Maîtres de thé), Tōkyō, Kōdansha, 2007.
Tōdaiji yōroku 東大寺要録 (Annales et anecdotes du Tōdaiji), 1106, Tsutsui Eishun 筒井英俊 (éd.), Tōkyō, Kokushokankokai, 1971.
Verschuer Charlotte von, Le commerce entre le Japon, la Chine et la Corée à l’époque médiévale, VIIe-XVIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Zhang Jianli 張建立, « Heian jidai kara Kamakura jidai ni okeru seicha » 平安時代から鎌倉時代における製茶 (Fabrication du thé de l’époque Heian à l’époque Kamakura), Geinōshi kenkyū, n°155, 2001.