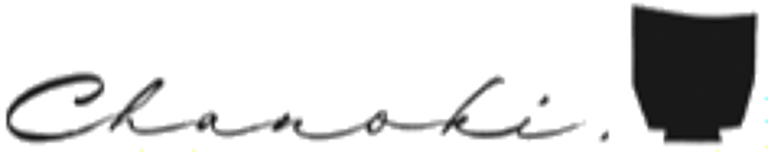Wakôcha : le renouveau du thé noir japonais
Découvrez le wakôcha, le thé noir japonais. De ses origines au XIXe siècle à sa renaissance récente, explorez l’histoire d’un thé méconnu.
THÉS
11/7/20253 min temps de lecture


Wakôcha : le renouveau du thé noir japonais
Le thé noir japonais, appelé wakôcha (和紅茶), ne représente qu’une infime part de la production de thé au Japon avec seulement 0,4 % de la production nationale. Pourtant, depuis les années 2010, il connaît un véritable essor qualitatif. Longtemps méconnu, le wakôcha s’impose peu à peu comme un thé qualitatif, révélant le savoir-faire des petits producteurs et une identité japonaise unique.
Une production ancienne mais oubliée
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la production de thé noir au Japon n’est pas une invention récente.
Dès la fin du XIXᵉ siècle, le Japon modernise son industrie du thé — mécanisation, sélection de cultivars, concours régionaux — dans le but d’exporter son sencha vers l’Occident. Mais la demande croissante en thé noir en Europe et aux États-Unis pousse le gouvernement japonais à s’y intéresser de près.
Les débuts : un projet d’État
En 1875, le gouvernement envoie Tada Motokichi, ancien samouraï du clan Tokugawa reconverti dans le thé à Shizuoka, en Chine, Inde et Ceylan (Sri Lanka) pour y apprendre les techniques de fabrication du thé noir.
À son retour, il rapporte des graines de théiers d'Assam (camelia sinensis var. assamica), à partir desquelles est créé le premier cultivar japonais destiné au thé noir : Benihomare.
Tada Motokichi est aujourd’hui considéré comme le père du thé noir japonais.
Le développement du thé noir japonais
Dans les années 1930, le Japon profite des restrictions à l’exportation du thé en Inde pour se positionner sur le marché mondial : en 1932, il exporte près de 6 400 tonnes de thé noir. Mais malgré des décennies d’efforts, la qualité reste inégale et le thé noir japonais ne parvient pas à s’imposer à l’international.
Les cultivars japonais à thé noir
En 1953, lors du premier enregistrement officiel des cultivars japonais, 5 sur 15 sont destinés à la production de thé noir :
Benihomare, Indo, Hatsu-momiji, Benitachiwase et Akane.
Malgré ces initiatives, le mouvement s’essouffle dans les décennies suivantes. De nouveaux cultivars apparaissent malgré tout — Benikaori, Benifuji, Satsumabeni, Benihikari — sans réussir à transformer l’industrie. Le dernier grand cultivar, Benifûki, est créé en 1965 (croisement entre Benihomare et un théier de Darjeeling), mais n’est enregistré qu’en 1993, alors même que la production de thé noir au Japon a presque disparu.
Le déclin après-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais contrôle le commerce du thé et oblige les entreprises à acheter du thé noir local pour pouvoir importer du thé étranger. Ce système maintient artificiellement la production. Mais lorsqu’il prend fin en 1971, la filière s’effondre brutalement. Le thé noir japonais est alors souvent issu de deuxièmes récoltes de plantations d'abord destinées à faire du sencha. Le cultivar Benihikari, pourtant prometteur, n’aura jamais l’occasion de briller.
Benifûki : du thé noir au thé vert médicinal
Ironie de l’histoire : le Benifûki, conçu à l’origine pour le thé noir, doit sa popularité non pas à ses qualités gustatives, mais à sa forte teneur en catéchine méthylée, reconnue pour ses effets supposés anti-allergiques découverts en 1999.
Il devient alors un cultivar prisé pour la production de thé vert puisque ces catéchines disparaissent à l’oxydation.
La renaissance du Wakôcha
Dans les années 2000, quelques producteurs passionnés continuent à fabriquer du thé noir, en visant d'abord une production de qualité, en mettant à profit aussi bien des cultivars à thé noir (Benifûki, Benihikari) qu'à thé vert (Kôshun, Misamisayaka). Ces thés noirs japonais séduisent aujourd’hui par leur équilibre, leur douceur et leurs arômes floraux et fruités. Le wakôcha moderne est un thé de niche, produit à petite échelle, révélant la diversité et la créativité des terroirs japonais et permet aux producteurs de l'utiliser comme porte d’entrée pour faire découvrir leurs autres thés.
Des concours et festivals dédiés au wakôcha voient le jour, organisés par des spécialistes du thé noir, signe d’une véritable reconnaissance.
Le Japon restera sans doute le pays du thé vert, mais son thé noir — quand il est bien fait — révèle une élégance subtile et typiquement japonaise.
© 2024. Chanoki
Abonnez-vous à notre newsletter
Maison de thé
Liens utiles
Chanoki
65 avenue Pierre Larousse Malakoff